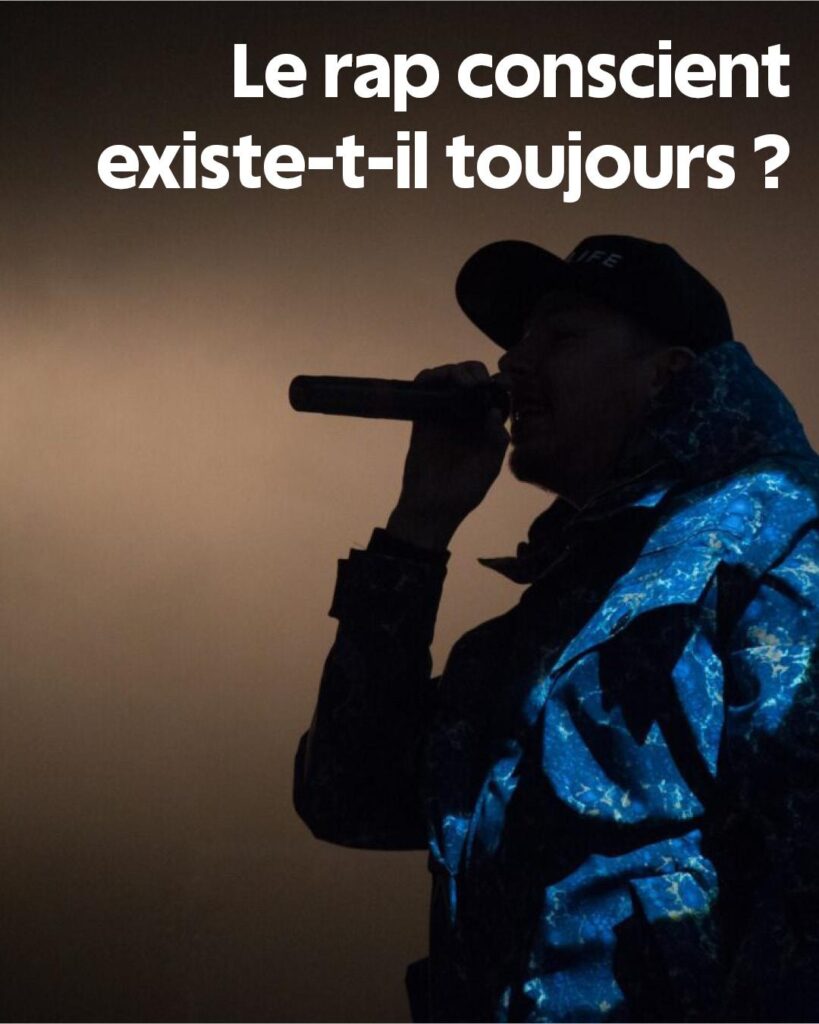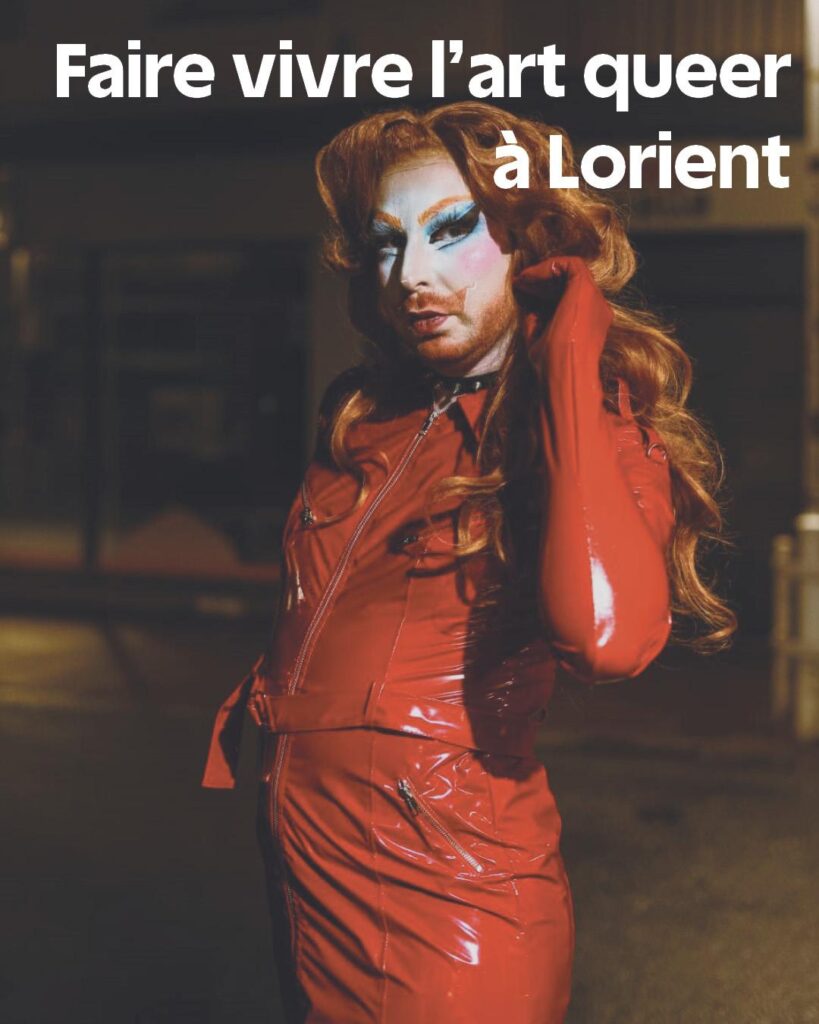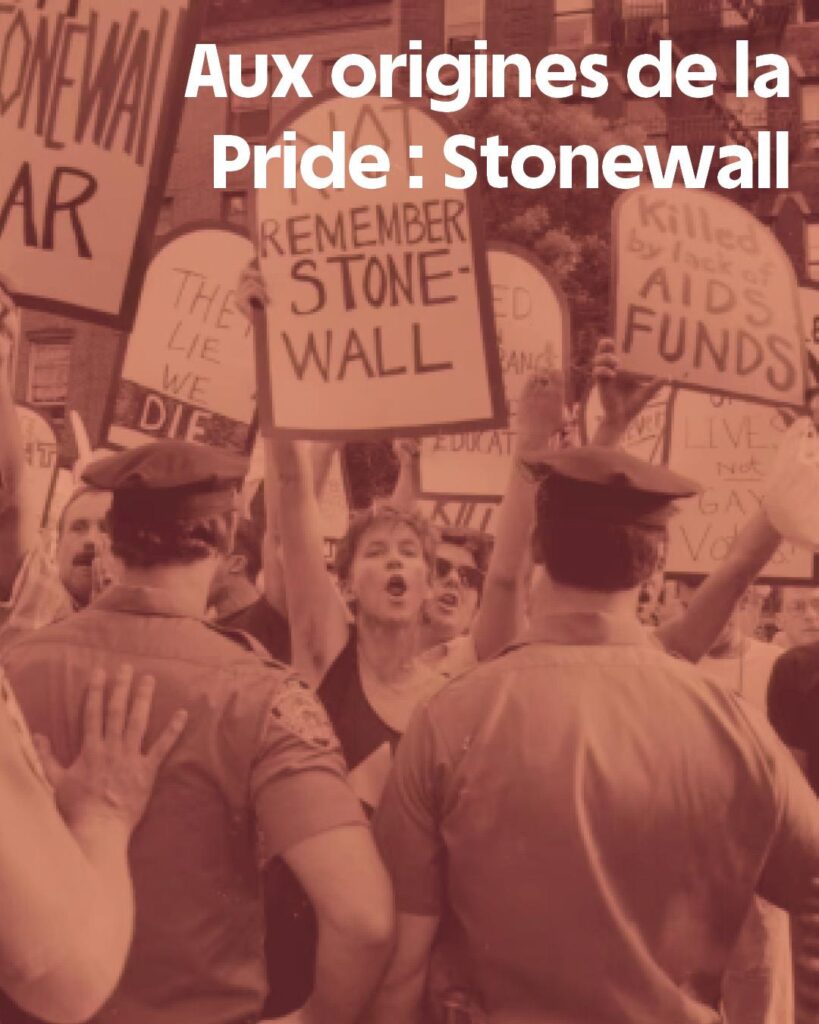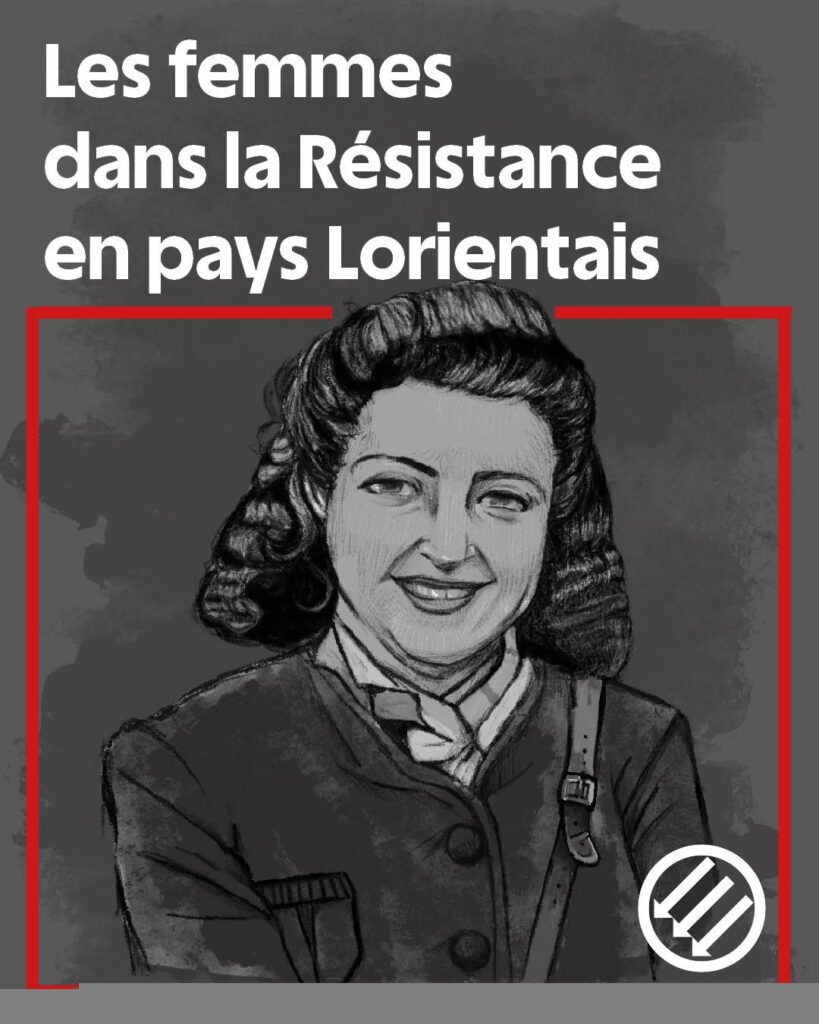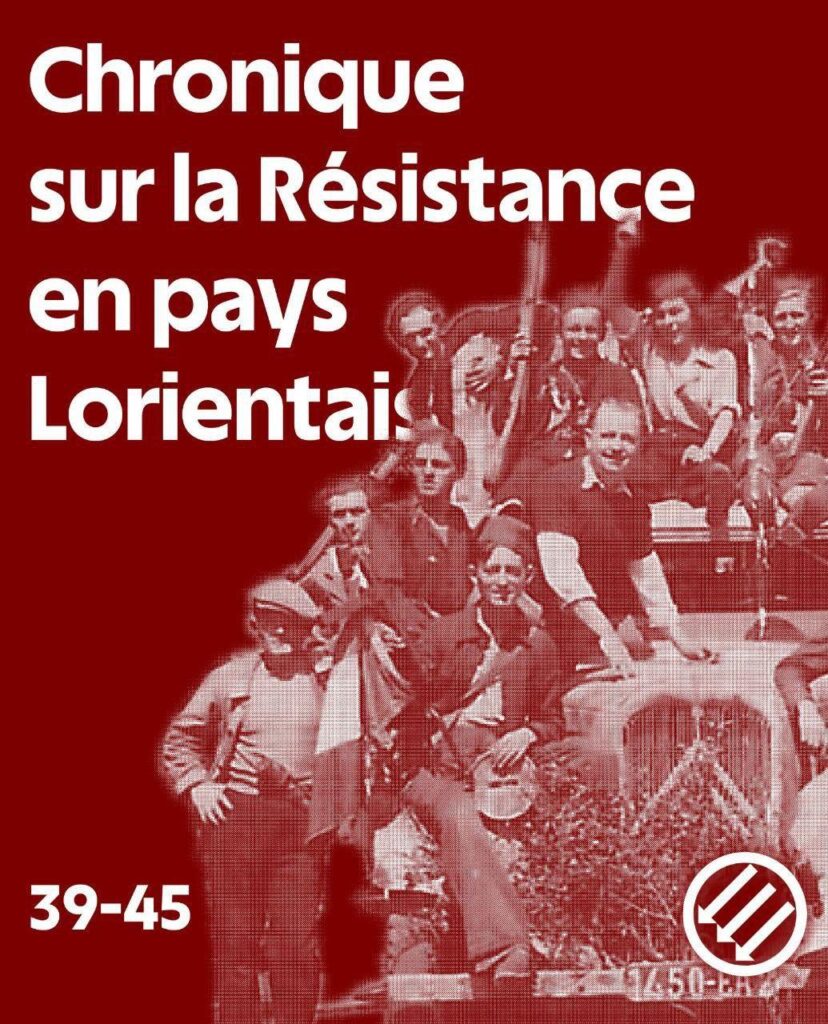Alors que le Festival Interceltique de Lorient (FIL) vient de toucher à sa fin, de nombreux témoignages de festivalier·ères nous remontent sur de nombreux contrôles d’identité. En cause ? Des banderoles déployées ou des drapeaux palestiniens portés sur les épaules.
Rien d’anodin puisque depuis plusieurs mois, en Hexagone, le drapeau palestinien fait l’objet d’un traitement singulier : sa seule apparition suffit à susciter des accusations simplistes de troubles à l’ordre public, des interventions policières, des gardes à vue, voire des mises en cause judiciaire. Ainsi, en amont, des contrôles abusifs sont menés à tout-va pour satisfaire le bourrage de crâne impérialiste soutenant toujours le régime de Netanyahu. Cette propagande est elle-même relayée par l’hystérisation de certains médias auprès de ses lecteurices.
Dans un communiqué transmis aux organisations partenaires et envoyé à la presse, l’AFPS du Pays de Lorient, dénonce des « faits inacceptables et honteux pour l’image de la ville et du festival » et recense au moins deux contrôles d’identité. Des chiffres qui sont en deçà de la réalité, puisque nous sommes en mesure de confirmer, avec vos témoignages, que près d’une dizaine de contrôles d’identité voir plus ont été réalisé au cours des dix jours de festival interceltique.
À l’exemple du dimanche 3 août où nous dénombrons au moins quatre faits. Le premier a lieu vers 11h au cours de Chazelles. Une banderole est déployée par des militant·es de la cause palestinienne lors de la Grande Parade des Nations Celtes. Dénoncé·es par certain·es spectateurices à la police, plusieurs militant·es sont arrêté·es,menotté·es, puis amené·es au commissariat lorientais pour une « vérification d’identité ». Cette vérification dure plus de deux heures. Une autre personne écope d’une amende. Aucune poursuite connue à ce jour.
Les trois autres faits ont lieu entre la place des Pays Celtes et le Kleub. Plusieurs jeunes individu·es sont contrôlé·es entre 22h et 23h sur la place névralgique du FIL par une dizaine de CRS. Ils exigent que la jeune femme retire de ses épaules le drapeau palestinien sur « ordre du commissaire ». La jeune femme demande pourquoi à plusieurs reprises. Selon son témoignage « aucune explication n’est apportée ».
Les deux suivants ont lieu à la sortie du Kleub, un lieu situé place de l’Hôtel de Ville. La jeune femme contrôlée auparavant est accompagné d’un ami. Il est contrôlé à son tour « pour savoir à qui on a affaire » selon son nouveau témoignage puis est « mis en garde » que si le drapeau palestinien reste sur ses épaules il risque de se « faire embêter à nouveau ». Les deux ami·es, au contraire, reçoivent des marques de soutien, des sourires et des remerciements par de nombreux·ses festivalier·ères présent·es sur les autres sites du FIL. Ici, nous saluons leur acte de résistance.
Enfin, un·e individu·e est de nouveau contrôlé·e car iel porte un drapeau palestinien sur ses épaules. Cette fois-ci, il y aurait un « arrêté préfectoral ». Les FDO qui effectuent le contrôle ne sont toujours pas en mesure de présenter un document officiel attestant de cet arrêté.
Le jeudi 7 août, vers 21h, au Quai du Livre, un couple franco-italien est interpellé par des CRS. L’homme qui ne parle bien français a du mal à comprendre ce qu’on lui reproche. Sa compagne traduit. L’AFPS explique dans son communiqué le « ton agressif des policiers qui lui intiment d’enlever son drapeau évoquant de manière vague qu’aucun drapeau autre que ceux des nations celtes n’est admis sur le site, au prétexte que le festival serait apolitique ». S’en suit un contrôle d’identité et des menaces d’être conduit au commissariat.
Le jeudi 7 août, vers 22h, un couple franco-asturien est prié de quitter illico presto le fest-noz de la salle Carnot et le Festival Interceltique de Lorient. Le jeune asturien est contrôlé sous prétexte qu’il arbore le drapeau palestinien.
Toujours ce jeudi 7 août, à 23h05, le couple franco-italien est de nouveau contrôlé. L’homme est « brutalement » aggripé par ses vêtements et « emmené contre une palissade ». À nouveau un contrôle d’identité est mené et que s’il persiste une troisième fois, il sera conduit au poste.
Quelques minutes plus tard, nous recevons des alertes de bénévoles présent·es sur différents sites et dont la police somme de « dénoncer les personnes portant le drapeau palestinien ». Ils expliquent également être à la recherche « d’espagnols ou d’italiens pro-palestiniens ».
Le vendredi 8 août, un·e individu·e subit un troisième contrôle de la semaine à la sortie du Kleub. Iel lui est notifié·e qu’un « arrêté municipal » portant sur le drapeau palestinien est en cours. Aucun document n’est présenté.
Ces quelques exemples sont issus d’une longue liste de faits non-exhaustive. Alors si la direction du Festival Interceltique de Lorient, rappelle que « Nous n’avons eu aucune remontée concernant ces faits » selon la presse régionale, on lui rappelle que la répression est toujours plus oppressante, ces derniers mois, et que nombre d’individu·es se taisent par peur de représailles.
L’organisation assure également n’avoir « donné aucune instruction officielle concernant le port du drapeau palestinien, encore moins une interdiction ». Face à cela, il est légitime de se poser plusieurs question.
Comment se fait-il qu’une représentante du festival a spécifiquement signifié que « le drapeau palestinien est interdit » ? Est-on en droit de prohiber le drapeau palestinien lorsqu’on se remémore l’histoire du Festival Interceltique ?
La réponse est bien évidemment non. On ne peut outrepasser qu’en 2005 puis en 2007, de jeunes musicien·nes palestinien·nes ont défilé avec le Bagad Guirab (signifiant cornemuse en arabe) lors de la Grande Parade des Nations Celtes, le triomphe des sonneurs et les différents défilés.
Pourtant, déjà à l’époque, ces palestinien·nes, comme des milliers d’autres, étaient expulsé·es de leur terre, entassé·es dans des camps en Cisjordanie, réfugié·es au Liban, ou bien même enfermé·es dans la bande de Gaza.
Ce message d’ouverture, de solidarité et de tolérance,associé à nos cultures minorisées, ne peut être oublier ou dévoyer aujourd’hui.
Dans la conjoncture actuelle, exprimer sa solidarité en arborant le drapeau palestinien est-il devenu un délit ?
En janvier 2023, Heba Morayef, directrice régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient d’Amnesty International soulignait que « depuis des décennies, le drapeau palestinien est un symbole d’unité et de résistance à l’occupation illégale d’Israël ; il est utilisé à travers le monde comme emblème de solidarité avec le peuple palestinien ».
Arborer le drapeau palestinien n’est pas un délit, au contraire, il marque toute notre solidarité et encore plus lorsque cinq journalistes parmi les derniers de Gaza sont tués. Lorsque des femmes palestiniennes accouchent sans anesthésie, allaitent sous les bombardements, et protègent leurs enfants avec leurs corps. Elles voient la faim les dévorer au point de manger du sable et inscrivent leur nom sur leurs bras « au cas où ». Les femmes palestiniennes déchirent leurs toiles de tente pour en faire des protections menstruelles de fortune, endurent des infections sans aucun soin possible. Alors oui, merci à celleux qui ont eu le courage d’arborer les couleurs de la Palestine au FIL 2025 comme ailleurs.
Enfin, au sujet d’un hypothétique « arrêté municipal », comme évoqué le vendredi 8 août, les services de l’Etat français se sont déjà prononcés « plusieurs fois sur le sujet : non, pour la justice, l’interdiction d’un drapeau n’est ni nécessaire ni proportionnée » comme le rappelle France Info, dans un article daté du 4 juin dernier.
EDIT : Le vendredi 8 août dernier, un bâteau accoste au port de Lorient. Vers 18h, environ dix minutes après l’arrivée de l’équipage, six policiers arrivent sur le ponton « nous ordonnant d’enlever notre drapeau ». Une des
personnes contrôlées explique que « nous avons demandé de nous
montrer le document qui spécifiait cet ordre. Ils nous ont répondu que c’était un arrêté préfectoral, mais qu’il ne l’avaient pas avec eux ».
S’en suit des contrôles d’identité en « spécifiant qu’ils ne pouvaient pas enlever le drapeau mais que si ce n’était pas fait, on recevrait sûrement une amende ».