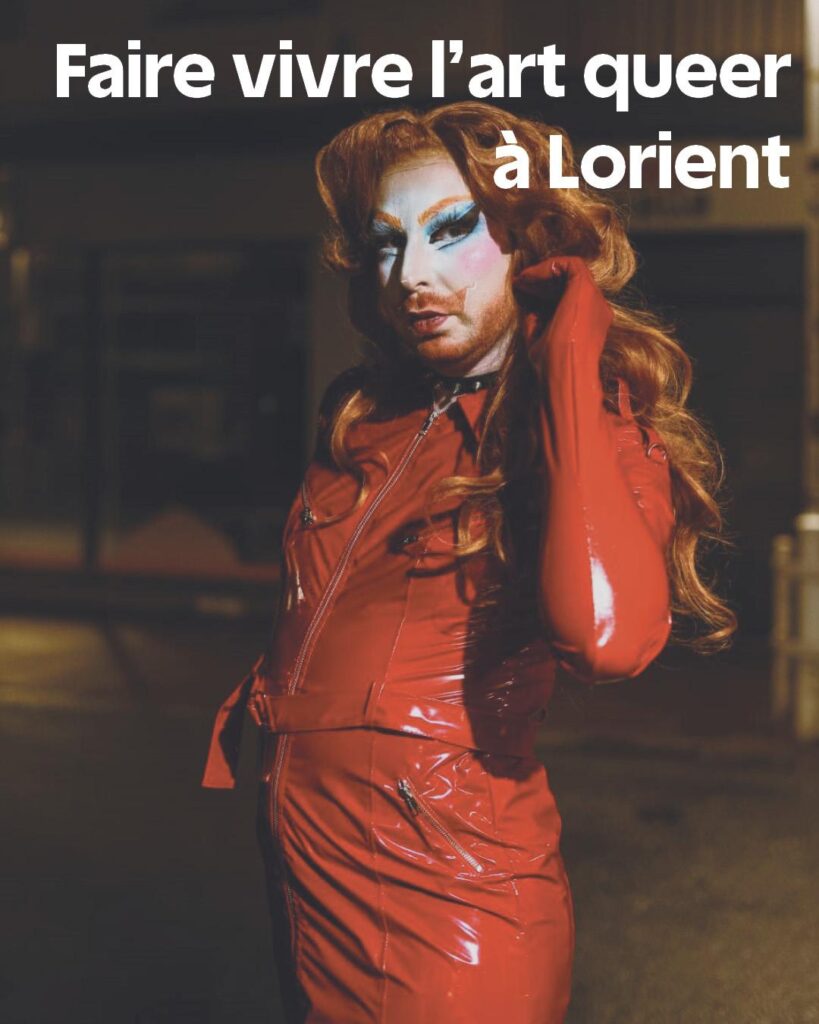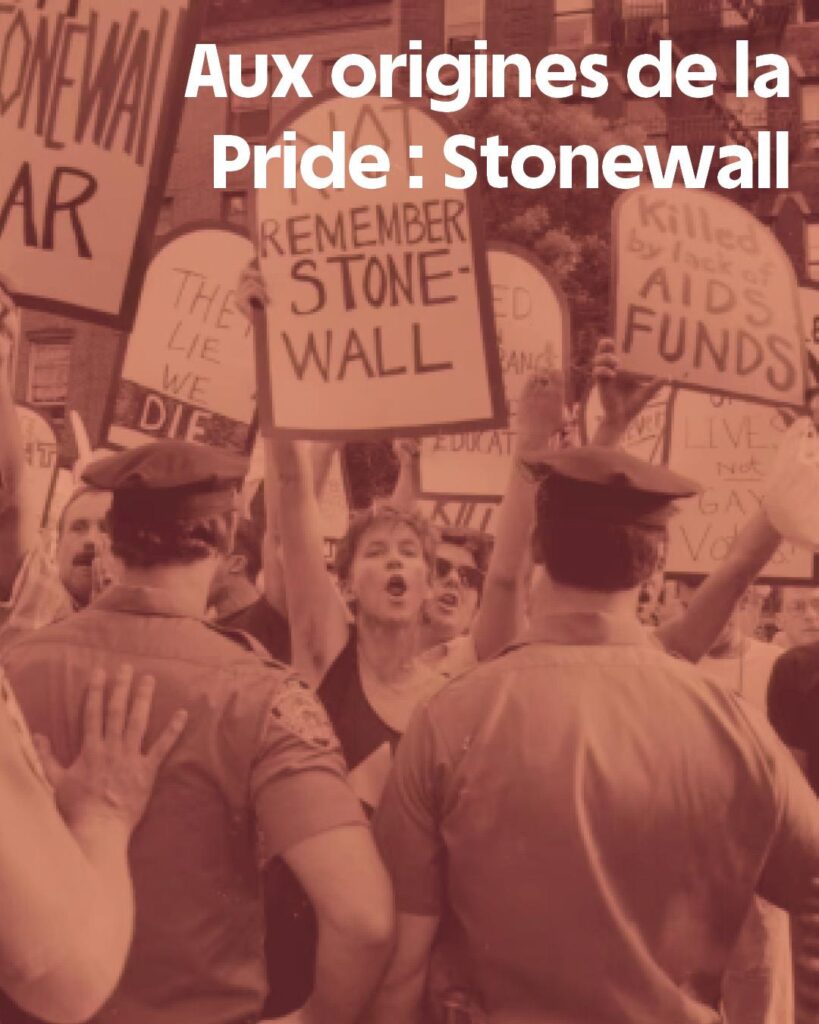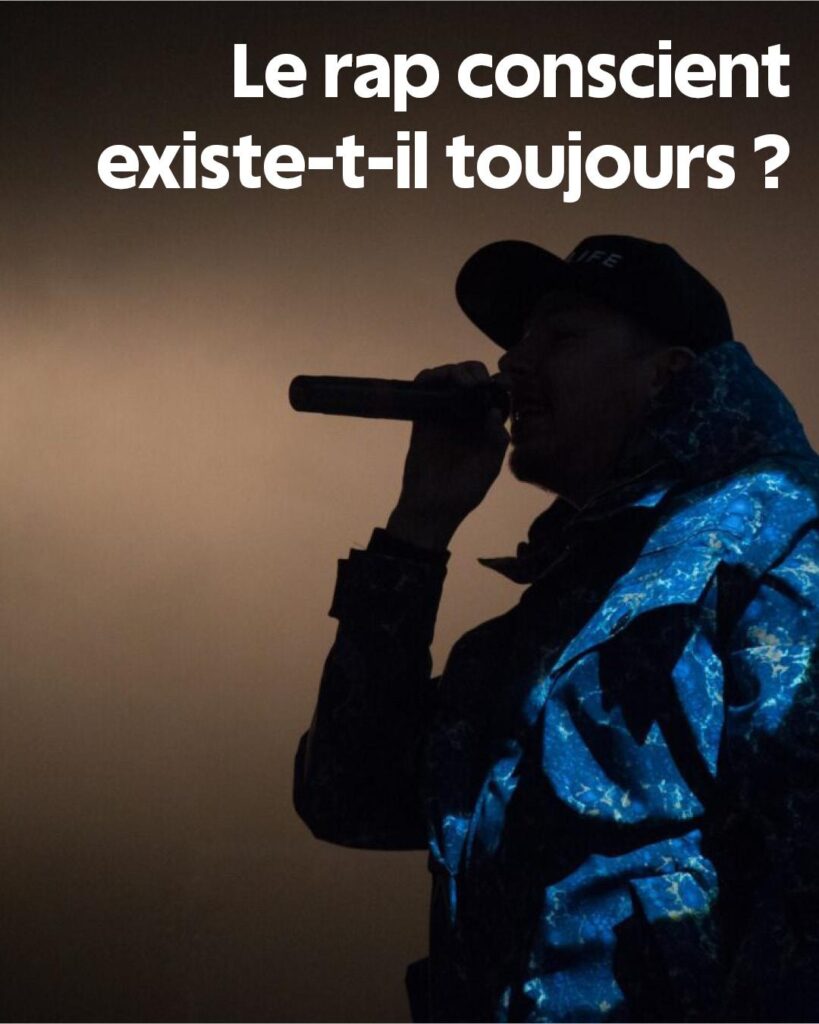
Alors que la saison estivale des festivals a déjà débuté, on va s’intéresser au rap, prisé par un public très large. Apparu dans l’Hexagone au cours des années 1980 sur le modèle du hip-hop étasunien, il prend rapidement de l’ampleur et devient populaire dans les années 1990. Si aujourd’hui de nombreux·ses artistes mainstream sont en tête des « charts » ou classements musicaux grâce à l’apparition du streaming, que des magnats d’extrême droite sont désormais actionnaires, que reste-t-il du rap engagé et militant ?
Avant de répondre à cette question, il parait important de comprendre à quel point l’apparition et l’expansion du streaming ont joué un rôle sur le rap. Ce dernier, qui est une des disciplines du hip-hop, est celui qui a connu le plus d’évolution ces dernières années : les battements par minutes ou BPM ont ralenti, les mélodies auto-tunés se sont imposés et les structures des morceaux se sont retrouvés complètement chamboulées.
Les plateformes de streaming, soutenu par le capitalisme musical ont bien saisi cela pour faire un maximum de profit. Ainsi, ensemble, ils mettent en avant des artistes plus « bankables », ciblent des tranches d’âge spécifique en leur proposant un rap parfois aseptisé et contribuent à effacer les repères historiques essentiels à la compréhension du rap.
Il se retrouve mis à la disposition et surtout mis en avant pour tout un pan d’individu·es en discordance avec ce qu’est le rap comme culture. « Le problème qu’on a avec un public qui est en décalage avec la politique, c’est que pour beaucoup du coup, ils vont passer à côté d’un message et un message qui est très important dans le rap » comme le soulignait Akashioupersonne pour Raplume en novembre 2023.
Peut-on oublier sa mémoire, sa transmission, son ancrage et ses histoires sociales ou politiques ? « Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position » ?
Les revendications sociales ou politiques s’inscrivent dans une longue tradition du rap hexagonal. Le 21 mars 1997, un collectif réunissant une vingtaine d’artistes sort un morceau culte engagé politiquement. Intitulé 11’30 contre les lois racistes, ce manifeste antiraciste bâti sur un projet artistiquement ambitieux rassemble les plus grands noms du rap des années 1990 : Ménélik, Fabe, Passi, Stomy Bugsy et bien d’autres. À cette époque, le rap français est très politisé. Les têtes d’affiche répondent à l’appel.
Dans le morceau, le collectif dénonce les lois mises en place par la gauche et la droite institutionnelle.
L’intro est percutante de suite : « Loi Deferre, loi Joxe, lois Pasqua ou Debré, une seule logique : la chasse à l’immigré. Et n’oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. » À travers ce morceau, c’est toute la classe politicienne qui est visée.
En octobre 1997, 60 000 exemplaires sont écoulés. Les fonds récoltés sont reversés au Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB) qui dénonce le racisme institutionnel dont sont victimes les réfugié·es, et en particulier les violences policières.
En 1998, Ärsenik, groupe de rap français, originaire de Villiers-le-Bel, rappelait la punchline « Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position » dans le titre Boxe avec les mots.
Cette punchline a été reprise depuis par de nombreux·ses artistes, dont Youssoupha dans Menace de Mort en 2012.
À cette époque, les rappeureuses sont en première ligne face aux attaques incessantes de tout un tas de journalistes, d’essayistes ou de politicien·nes de droite extrême et d’extrême droite qui estiment que le rap est une « sous-culture ». De nombreux·ses artistes prennent alors position et en parlent dans leurs musiques.
Aujourd’hui, le rap s’est développé, truste la tête des charts ou des plateformes de streaming. Des juristes relisent les textes pour vérifier que rien n’est condamnable d’un point de vue légal, les chef·fes de projet mettent des freins sur les textes qui pourraient nuire à la promo, et les artistes eux-mêmes se censurent en réfléchissant plus en termes de plan de carrière que de musique.
Pire encore, des magnats d’extrême droite comme Bolloré sont désormais actionnaires de labels !
Ce cocktail fait que des artistes ont de plus en plus de mal à condamner des positions prisent par des médias, par des politiciennes et par un système étatique.
Lorsque la parole est prise, comme dans No Pasarán avec 9’43 contre les fachos, l’initiative est sans doute salutaire, mais elle intervient bien tardivement.
Pourquoi sortir le morceau au lendemain du premier tour des élections législatives de 2024 quand on sait que l’extrême droite et ses partisan·es redoublent et accentuent les attaques sur nos camarades depuis plusieurs années ? À titre d’exemple, lors des révoltes populaires du mois de juillet 2023 suite à la mort de Nahel, des milices s’évertuent à livrer des personnes racisées à la police française.
À cette même période, sur le pays lorientais, l’extrême droite locale intimide nombreux·ses de militant·es ou d’événements.
Les textes de No Pasáran sont inégaux, souvent confus et conspirationnistes. Un discours qui tranche avec son ancêtre du 11’30 contre les lois racistes.
Dès lors faut-il repenser notre rapport au rap ? Existe-t-il des artistes à contre-courant et engagé politiquement ?
Alors, oui, il existe des contre-exemples !
Le 13 décembre 2020, un collectif de 33 MC’s sort un morceau plus que jamais d’actualité. Dans un contexte ravivé par le mouvement des gilets jaunes, par les meurtres de Zineb Redouane, de Steve Maia Caniço, de Cédric Chouviat ou par la loi sécurité globale.
13’12 contre les violences policières narre le racisme et les violences policières. Dès le début, le clip fait mouche, les textes sont talentueux, et des illustrations d’images qui nous rappellent combien l’Etat français a déchaîné sa milice tout au long de ces dernières années.
De Skalpel à Billie Broke, en passant par L’1consolable à de Tideux, les punchlines sont acérées ! Une belle découverte musicale.
Un autre artiste cristallise tout ce que l’Etat français et l’extrême droit déteste, le rappeur Médine. De par son tempérament et ses textes criant de vérité, Médine représente à lui seul tout ce que les politiciennes déteste : de l’annulation de ses concerts jusqu’aux menaces de mort, tout est bon pour nuire à un artiste qui fait de la lutte pour la justice sociale un cheval de bataille de ses chansons.
Dans Généric, il livre un récital et un hommage à l’antifascisme. Dans Stentor, il réalise son clip aux côtés de plusieurs militantes de collectifs antifascistes où il explique « Nique les fafs, les Waffen-SS (Nique les fafs, les Waffen-SS), J’suis pas Stanislas, un peu Averroès ».Avec L’4mour, clip officiel du spectacle La Haine, il souligne « Mais, dans les contrôles de routine. On est des ramasseurs de balles. Mais tu veux savoir c’est quoi l’comble? C’est qu’ce soir, on fait salle comble ».
Le 29 avril 2023, Médine se produit à Lorient dans une salle comble. Quelques semaines auparavant, l’extrême droite locale et leurs nervis tentaient d’annuler la venue de SOS Méditerannée.
Ils en feront de même pour la venue du rappeur en se plaignant dans la presse régionale.
Ce soir-là, Médine fera danser et chanter plus de 500 personnes autour de ses sons cultes, du « Siamo Tutti Antifascisti » et du drapeau antifasciste Breizh Enepfaskour.
Il conclut son concert par « Lorient, j’avais aucun doute ce soir, le message est reçu ».
Car si Vald expliquait en mars 2025, sur le plateau de Quotidien, que si le rap est « de gauche quand il se veut militant, quand il essaie de décrire des trucs, il est de droite quand il est content d’avoir des grosses voitures », pour nous, il doit être engagé et militant ! Continuons, dans les manifestations à porter ce message, continuons à fleurir les têtes de cortèges de banderoles en reprenant les paroles d’artistes. Sur les réseaux sociaux, utilisons les audios de rappeureuses engagées dans nos publications.
Ces deux exemples récents sont loin d’être exhaustifs, nous vous invitons à venir l’enrichir en commentaires. Aussi, nous découvrons à peine la scène engagée régionale et internationale qui se mobilisent à travers leurs messages, mais nous en sommes sûr·es, soutenons les !