3 # LES GROUPES FTPF VAILLANT-COUTURIER ET CORENTIN CARIOU ANIMENT LE PAYS DE BUBRY
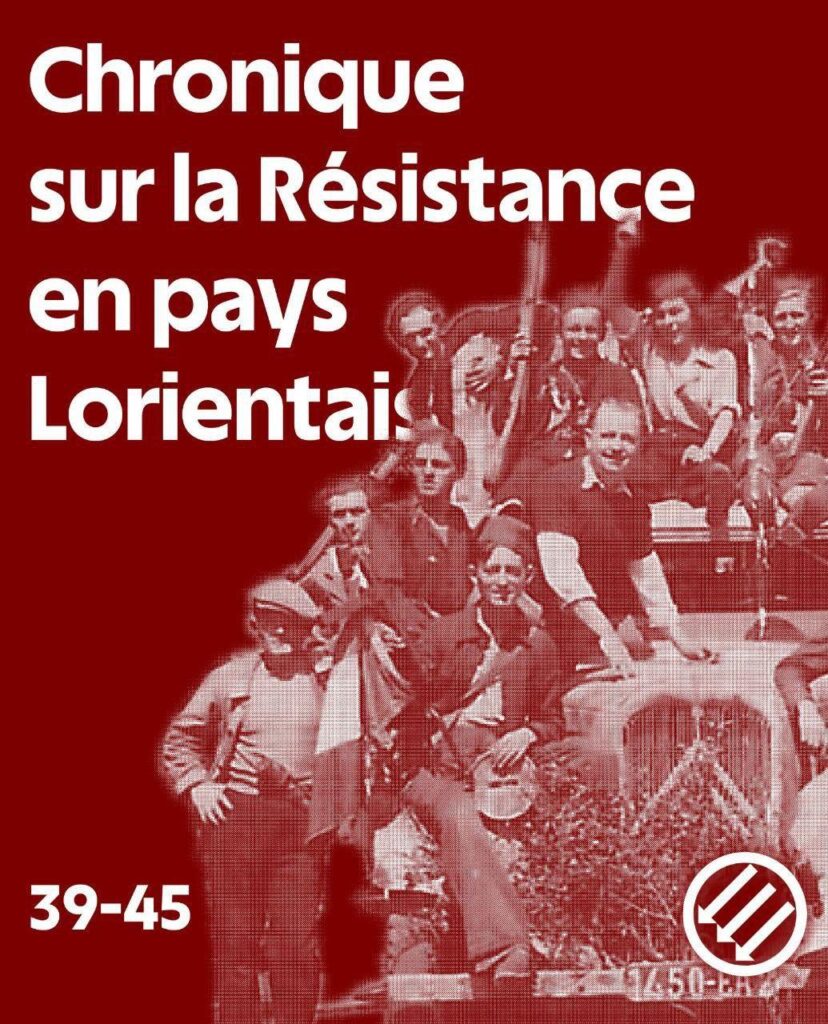
On l’a vu, dès 1941 voir avant, les contours de la Résistance se dessinent autour du renseignement, d’initiatives locales et des premiers attentats ou sabotages.
Au cours de l’année 1941, un groupe de jeunes combattants se constitue à Lorient sous la houlette de Joseph Le Nadan. Pierre Theuillon, un de ses camarades, réussit à louer une pièce dans une maison de la rue Edgar Quinet, au nez et à la barbe de l’occupant nazi. Une imprimerie clandestine s’installe dans le grenier. Des tracts sont fabriqués puis diffusés à Lorient, Keryado, Lanester et Hennebont, mais aussi dans les régions du Faouët, Quimperlé, Gourin, Guémené-sur-Scorff et Bubry.
C’est à Bubry et Quistinic, situés en zone rurale et à 37 km de Lorient, qu’en juin 1942, Émile Le Carrer dit « Max », âgé de 20 ans, s’emploie à organiser un groupe d’action. Auparavant formé à Quimperlé, il réalisait plusieurs coups d’éclats, comme le dépôt d’une bombe devant la Kommandantur de Quimper.
À l’automne 1942, sous l’impulsion de René Jehanno, d’Émile Le Carrer et de Le Du, le groupe Vaillant-Couturier des FTPF (Francs-Tireurs et Partisans Français) voit le jour à Bubry. La plupart du temps, les FTPF se constituent en petits groupes, portés par des initiatives locales soit sur la base de l’ancienne OS (Organisation Secrète) ou par des initiatives de militant·es communistes. Les groupes FTPF sont composés d’une dizaine d’individu·es dont un chef de groupe et son adjoint (ou chef de demi-groupe).
Formé à la clandestinité au printemps 1943 dans le maquis de Bochelin Vihan, Vaillant-Couturier multiplie les actions, épaulé quelques mois plus tard par le groupe FTPF Corentin Cariou de Quistinic. Parmi ses groupes, on retrouve Yvonne Nicolas, qui deviendra plus tard une brillante agente de liaison pour la Résistance. Une vingtaine de déraillements de convois nazis sont constatés à l’été 1943. Les destructions de lignes électriques et téléphoniques, l’auto-réduction de matériel, de tickets d’alimentation et de tabac s’étendent.
Les groupes accueillent également des jeunes refusant le Service du Travail Obligatoire (STO). Institué le 4 septembre 1942 par le gouvernement vichyste, le STO doit répondre aux exigences nazies de main d’oeuvre. On estime qu’un total de 600 000 à 650 000 travailleurs français sont acheminés vers l’Allemagne entre juin 1942 et juillet 1944.
Le 30 novembre 1943, le groupe Vaillant-Couturier attaque la gendarmerie de Guémené-sur-Scorff en représaille après le tir d’un coup de feu par un gendarme collabo sur Émile Le Carrer. Un soldat nazi est tué. Les actions se durcissent.
Pourchassé par l’Allemagne nazie et dénoncé par un paysan de Malguénac, huit jeunes résistants sont arrêtés par la gendarmerie de Pontivy en décembre 1943.
Stationnés dans la ruine de Barrac’h à Malguénac, Raymond Guillemot, Joseph Le Mouël, André Le Mouël, Jean Mahé, Ferdinand Malardé, Jean Robic, tous originaires de Bubry, ainsi qu’André Le Garrec et André Cojan sont livrés aux allemands nazis. Un résistant parvient à s’enfuir, tandis que deux autres sont déportés.
Les cinq autres, Mahé, Robic, Malardé, J.Le Mouël et Guillemot, sont exécutés pour actes de sabotage sur les voies ferrées (7 déraillements au total), le 25 février 1944, dans la prison de Vannes, place Nazareth.
Raymond Guillemot, qui a vécu à Lanester, est fusillé à 10h13 avec son camarade Ferdinand Malardé. Ils ont tous entre 19 et 24 ans.
Dans leurs lettres d’adieu, ils expriment « leur aspiration au bonheur pour ceux qui vont survivre ». Même face au peloton d’exécution, ils ne baisseront jamais la tête. Dans un extrait, Raymond Guillemot note : « Je m’en vais le cœur calme avec la satisfaction d’avoir fait mon devoir ».
Le 7 février 1944, une rafle est organisée dans la région de Bubry, Baud, Camors et Quistinic par les rats nationalistes de la Bezen Perrot (créée par Célestin Lainé et intégrée dans les SS) et de Vissault de Coëtlogon ainsi que par des feldgendarmes nazis. Dix-sept résistants et civil·es sont arrêté·es durant l’opération.
Interrogé·es dans l’école de Baud, puis transféré·es à Rennes, iels sont déporté·es en Allemagne. Quatre personnes meurent en déportation.
Si sur le terrain, c’est un coup dur, les actions vont se déplacer à Quistinic, avec le groupe Corentin Cariou, dirigé par les frères Gan de Kéramour, début 1944. Les échanges entre les résistants de Bubry et de Quistinic se centralisent alors au niveau du bois de Kerdinam.
Le 15 avril 1944, le groupe FTPF Corentin Cariou attaque un poste d’observation anti-aérien allemand installé au village de Loge-Picot à Quistinic dans le but de recevoir des parachutages d’armes. Deux nazis, dont un maréchal des logis-chef et un caporal-chef, sont tués au cours de cette attaque qui sera suivi de terribles représailles.
Le 17 avril 1944, Joseph Perron est arrêté et torturé avant d’être transféré au Fort de Penthièvre, où il décède des suites des sévices subis. Le 18 avril 1944, Marcel Le Teuff est abattu lâchement par une rafale de mitraillette dans la prairie de Ty-Parez à Quistinic.
Le 21 avril, trois FTPF de Corentin Cariou, Émilien Gahinet, Henri Guillo et Louis Le Ruyet sont exécutés dans une cache d’armes située dans le bois de Kerdinam.
Leurs corps sont retrouvés le 23 avril 1944 dans une fosse appelée depuis le « trou des martyrs ».
Arrêté également le 21 avril, Raymond Péresse est torturé à Locminé, où il décède le lendemain. Le 22 avril, une cinquantaine d’habitants de Quistinic sont raflés puis envoyés en Allemagne sous la contrainte. Le 1er mai, Mathurin Guégan est tué à son tour à Quistinic.
Aux 27 résistantes quistinicois·es et aux tant d’autres, décédé·es en martyr·es, ne nous vous oublions pas !
Une fois de plus, malgré les pertes, les résistant·es vont faire preuve d’abnégation. Iels continuent le combat pour harceler l’occupant nazi, en perturbant et ralentissant les possibles renforts de troupes en route vers la Normandie.En août 1944, les résistant·es locaux sont incorporé·es aux FFI (Forces Françaises de l’Intérieur).
Iels ont alors la mission de stabiliser le front et de participer à la libération de la Poche de Lorient.